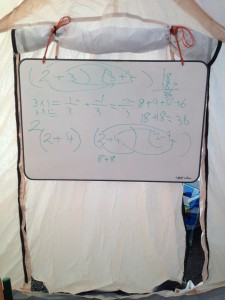« Oyez, oyez, Européens, prenez garde, le Moyen-Orient débarque et vient envahir votre espace, voler vos boulots, imposer sa culture et même, se faire exploser dans vos métros ! » C’est certes un peu grossier, mais ces quelques mots ne se font pas si rares dans nos contrées, bien souvent à peine voilés ou clairement assumés. Pourtant, qui peut prétendre connaitre le sujet ? Combien d’entre nous ont rencontré ces “réfugiés”, ces “immigrés” comme on se limite à les définir, qu’ils soient d’Irak, de Syrie, d’Erythrée, catholiques ou musulmans ? Le projet « Sois mon ami » rend cet échange possible. Il a ainsi pour unique mission de permettre la rencontre entre un citoyen belge et un demandeur d’asile, libre à eux, ensuite, de nourrir cette mise en contact comme ils l’entenden. C’est en cela que je trouve la démarche toute particulière : « Sois mon ami », sous son nom qui peut paraitre franchement niais, permet une relation entre nous et eux sans que celle-ci ne soit basée sur la démarche habituelle de l’aidant et de l’aidé.
Cette mauvaise habitude serait, selon moi, due au fait qu’on aborde la vague migratoire de manière très, voire trop, dichotomique comme si elle générait uniquement des positions tranchées entre d’une part ceux qui crient haut et fort leur refus d’accueillir toute la misère du monde et les gentils qui leur apportent la soupe et les pulls pour l’hiver. Dans les faits, ce contraste me semble également perceptible. En allant aider au camp de réfugiés de Calais, j’ai été frappée par les réactions violentes de certains des Calaisiens face aux migrants mais, surtout, par le manque de prise en charge de ces personnes. Arrivées et laissées là dans ce qui semblait la plus grande indifférence des autorités qui avait l’air de s’appuyer exclusivement sur des bénévoles pour faire tourner le camp. L’aide offerte par ces volontaires ne peut être à la hauteur des besoins de 6000 hommes, femmes et enfants sans une organisation plus vaste proposée par le pays d’accueil (bien qu’il n’ait ici rien d’accueillant !).
A l’inverse, lors de ma visite au camp de réfugiés de Grande Synthe, l’aide apportée aux migrants était manifeste. Le maire de la ville, Damien Carême, a en effet lancé les démarches permettant au camp de répondre aux normes internationales. Les habitants du camp ont ainsi accès à l’eau courante, l’électricité, des repas et autres produits de premières nécessité. Ils peuvent ainsi tout simplement vivre décemment, bien que dans un confort minimaliste. De plus, certains postes sont rémunérés et permettent la présence continue de gérants et de l’organisation qui les accompagne plutôt qu’une aide basée sur des bénévoles venus passer quelques jours à tour de rôle. Pourtant, à Grande-Synthe, l’aide m’a parfois semblé comporter un rapport aidant –aidé trop important. En effet, le camp reste un endroit de transit où les personnes n’attendent rien d’autre que la nuit pour tenter la traversée de la Manche vers l’Angleterre alors que les journées sont longues et vides. Sachant ceci, quel sens il y a-t-il à faire venir des bénévoles pour construire et isoler leurs cabanes? En effet, nous travaillions sur leurs toits alors qu’eux, en dessous, dormaient fatigués de ne rien faire, pendant que d’autres bénévoles préparaient les repas distribués ensuite à tout le camp. Je suis persuadée que certains auraient amplement préféré participer à ces tâches avec nous, que ce soit pour s’occuper ou tout simplement pour ne pas dépendre entièrement de volontaires. Les migrants étaient, par ailleurs, demandeurs de pouvoir cuisiner par eux-mêmes (chose qui sera normalement possible très prochainement).
Par surcroit, il me semble que pour nous aussi, il aurait été plus enrichissant de travailler ensemble que de rester dans ce cadre d’aidants-aidés. L’échange n’aurait été que plus cohérent. En effet, je pense que souvent, même en voulant bien faire, notamment en contribuant aux organisations d’aide aux migrants, on risque de tomber dans le misérabilisme, d’enfermer les personnes réfugiées dans une image de victimes. Or, cette démarche nous empêche de voir ces personnes au-delà de leur statut de réfugiés.
C’est en cela que je constate la pertinence de « Sois mon ami » qui propose avant tout des rencontres entre deux personnes. Lors d’un entretien avec Mohamed, cette réalité m’a tout particulièrement frappée. Mohamed, originaire de Damas qu’il a fui ne voulant rejoindre ni l’armée syrienne, ni l’armée libre, ni Daesh, a 28 ans et est arrivé en Belgique en septembre. Il nous a raconté son parcours depuis Damas jusqu’à la table du fond du Belga. Etrangement, ce qui m’a le plus étonné, n’était pas le contenu de son propos mais le fait que Mohamed ne m’a absolument pas paru étranger. Cela est sans doute dû en partie au fait que tout l’entretien s’est déroulé en français, qu’il maitrise grâce aux cours qu’il suit. Aussi, alors qu’en voyage l’humour m’apparaît toujours comme étant une marque culturelle très forte, nous rigolions ici des mêmes choses. Spontanément, après l’entretien, nous sommes restés encore un moment, notamment à parler des différences culturelles qui existent (certes et heureusement !) entre nos deux pays. Pourtant, cela ne m’a pas semblé plus exotique qu’une conversation entre copains sur les différences d’éducations de nos familles respectives.
Ainsi, il me semble qu’un juste équilibre doit avoir lieu entre, d’une part, reconnaître la nécessité évidente d’un besoin de prise en charge de ces personnes venues de loin pour fuir la guerre (ce que l’on oublie parfois) et, d’autre part, la conscience que toute personne, quel que soit son parcours, veut rester digne et ne pas être assimilée, identifiée, uniquement au fait d’être un migrant, que ce terme invite à des réactions de rejet ou d’aide. « Sois mon ami » suggère de considérer ces personnes avant tout comme des hommes, des femmes, des enfants : des gens comme nous.
Marion Alarcia