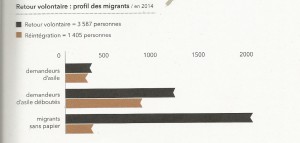De générations différentes, Lucie, 30 ans, Emmanuel, 53 ans et Alphonse, 69 ans, sont tous trois Congolais. Chacun d’entre-eux, par leur histoire, offre un regard critique de ce qu’est l’accueil en Belgique. Emmanuel et Alphonse sont tous deux arrivés comme étudiant boursiers, puis devenus réfugiés politiques, Lucie, dont le père est arrivé deux ans plus tôt, également comme étudiante boursière, avant de trouver du travail, est, quant à elle, arrivée par le biais du regroupement familial, ne faisant aucune demande d’asile.
Du statut de « Défalupro » à la « Persona non grata »
Étudiants boursiers, de nombreux Congolais se sont rendus en Belgique à partir des années 1960 afin de s’y former. Devenu indépendant le 30 juin 1960, le Congo ne dispose alors que de très peu de cadres, voire aucun. En effet, comme le souligne Alphonse, c’est le slogan « Pas d’élite pas de problème » qui aura été le mot d’ordre durant toute la durée de la colonisation belge. Nombreux sont ainsi les Congolais qui se rendront en Belgique avec le statut « Défalupro », statut défini par un séjour temporaire, limité à la durée des études et interdisant à tout Congolais de travailler. Ce n’est qu’à partir des années 1980, qu’apparaît de façon significative l’émigration congolaise en Belgique sous le statut de réfugié politique. En effet, depuis 1961, le Congo est gouverné par la dictature de Mobutu qui prit place suite à l’assassinat de Patrice Lumumba. De nombreux Congolais venus étudier en Belgique se voient alors inscrits sur la liste du régime comme « persona non grata », suite à leur position politique très critique à l’encontre du régime mobutiste. D’autres doivent fuir le territoire, face à la répression du régime. Cette émigration se poursuivra dans les années 1990, suite au maquis de Laurent-Désiré Kabila, communément nommé Kabila Père, qui prit le pouvoir en 1996, puis son assassinat et l’arrivée de son fils, Joseph Kabila qui devrait quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat présidentielle en 2016, si celui-ci ne s’y oppose pas. Alphonse et Emmanuel font partie de ces Congolais qui se sont rendus en Belgique pour s’y former et qui très rapidement après leur arrivée ont été considérés comme des opposants au régime. Le retour au pays n’est plus envisageable. C’est ainsi que si Alphonse a pu, à partir de 1995, retourner sur le territoire congolais, il n’en est pas de même pour Emmanuel qui est toujours inscrit sur la liste des « persona non grata » du pouvoir en place, toujours vu comme un opposant politique.
Du colonialisme au néocolonialisme
Face à l’histoire politique du Congo, les questions de l’interventionnisme occidental et du néocolonialisme sont fortement dénoncés, ainsi que le discours politique et médiatique véhiculé en Belgique auprès de la population belge, qui offre une vision de « l’Africain et de l’homme noir » lié à une idéologie dominante. Si les termes utilisés par les trois intervenants sont amenés à différer, le regard critique posé par ceux-ci quant à la politique étrangère européenne face à la démocratie se fait échos. C’est ainsi qu’Emmanuel dira « la politique étrangère pose véritablement problème à la démocratie. C’est le gros orteil rouge de la démocratie ou la négation des valeurs. ». Ce point de vue est partagé par Alphonse, « le néocolonialisme est l’anti-thèse de la démocratie et de l’indépendance. Puisque le néocolonialisme n’est rien d’autre qu’un emballage qu’on a changé en laissant le produit du colonialisme. Puisque le colonialisme c’est dominer les autres, nier leurs valeurs. » Lucie semble, quant elle, moins directe sur la question même si son point de vue rejoint le leur. « L’Occident s’en fout du reste du monde. Quand ils font quelque chose, il ne faut jamais prendre ça comme s’ils le faisaient pour le bien ». Les notions de démocratie et de valeurs sont pour eux fortement mises à mal par la politique occidentale ou étrangère, empêchant les pays de la région de se stabiliser. « On ne permet de se développer pour offrir tout le bonheur qu’il recèle à ces habitants, » déplore Alphonse. Sans compter que pour eux, l’arrivée de populations dites « immigrantes » est la principale résultante des guerres dont les pays européens sont, en partie, responsables. Le terme Boomerang reviendra ainsi à plusieurs reprises pour qualifier les événements actuels mais également passés, tel que l’immigration congolaise. Pour Alphonse, « ce sont les crimes de l’Occident, des pays européens qui font que les conséquences leur reviennent en boomerang. […] Fuir la misère, fuir les guerres, pour venir investir l’Europe. L’immigration, c’est la conséquence des actes criminels des gouvernements occidentaux. » Idée partagée par Emmanuel. « C’est une politique étrangère qui est criminelle. Les mêmes valeurs que l’on défend ici, elles sont complètement bafouées. Il s’agit de politique étrangère. »
Réfugiés ou migrants ? Quel accueil ?
Par ailleurs, leur perception de l’accueil des « réfugiés » et non pas des « migrants », terminologie sur laquelle ils insistent, dépend principalement de deux acteurs qui ont joué un rôle différent, à savoir la population et l’administration. En effet, « le regard qu’on va poser sur les gens qu’on appelle réfugiés est différent, en découlent alors des solutions différentes », souligne Emmanuel. Ainsi, selon eux la population a en grande partie accueilli « positivement » les réfugiés. « Heureusement, [certains sont prêts à aider] c’est ce qui sauve l’humanité. » Au niveau administratif, Lucie considère qu’ils ont été accueillis comme « moins que des chiens », « C’est difficile le fait de partir. Et en plus tu pars, pas parce que tu le veux, mais parce que tu n’as pas le choix, parce qu’il y a la guerre. Arrivé ici, tu te fais traiter comme moins que rien, même un chien a des droits. » De son côté, Emmanuel tendra plus à observer la question sous le prisme institutionnel. « Maintenant au niveau institutionnel, pour moi, non, ce n’est pas la solution puisque, comme je dis, on ne questionne pas les causes. On trouve donc de mauvaises solutions, comme l’accord avec la Turquie. On marchande, ça devient de la marchandise. L’accueil… Si on peut appeler ça accueil entre guillemets. »
Discours politique et médiatique, une propagande ?
Au niveau du discours médiatique, le monopole des médias « occidentaux » sur le point de vue véhiculé est mis en exergue. Ainsi, Emmanuel soulève le fait que les médias africains n’ont pas les moyens de disposer de correspondants locaux. Lucie met, elle aussi, en évidence l’absence de télévisions africaines ou asiatiques sur le territoire, ne pouvant alors pas filmer en Belgique ce qui s’y passe, comme à l’Office des étrangers, et de la sorte proposer un autre point de vue. Sans compter que « tout ce qu’on nous montre à la télé, faut pas oublier aussi que c’est de la politique, c’est de la propagande. C’est tout faire pour qu’ils ne puissent pas venir ou bien tout faire pour avoir plus de fonds de l’Europe. C’est pas parce que c’est à la télé, que c’est réel. » Pour sa part, Alphonse ne suit plus aucun média, « Il n’y a plus de médias de vérité. C’est des médias de propagande. » De plus, selon eux, politiques et médias ne questionnent pas assez les causes à l’origine de cette « crise », s’il y a crise… En effet, si crise il y a, ils la qualifieraient davantage d’humanitaire. « Est-ce que c’est vraiment une crise migratoire ou bien est-ce juste une façon d’afficher les choses parce qu’on ne veut pas, parce qu’on a peur, etc. ? » s’interroge Lucie. Pour Emmanuel, « Oui, il y a crise, d’une certaine manière. Dans la mesure où c’est inattendu. C’est du jour au lendemain […] et en nombre important. […] Mais non également, si tu prends toute l’Union européenne et le nombre de personnes qui arrivent sur l’espace européen, ça représente, je ne sais même pas, 0,1% ? C’est rien. Donc de ce point de vue là, il n’y a pas vraiment de crise, si on veut bien les accueillir. » Finalement, « comme toujours, si on regarde les salaires d’aujourd’hui, ce qu’ils valent, ce que les gens gagnent aujourd’hui, on est revenu à la situation de 1965 et il y a eu des gouvernements entre temps et qui n’ont pas fait ce pourquoi ils doivent travailler. […] Des mauvaises solutions comme souvent. Et la question des réfugiés n’échappe pas à ça non plus. Pour toutes les questions, par exemple, la question du réchauffement de la planète, on ne prend pas les bonnes solutions. Parce que les politiciens font du court-termisme : « si je fais ça, est-ce que je serai élu » chose qui leur importe. »
Pour quelle intégration.
Quant à la question même de l’intégration, peut-on un jour réellement s’intégrer ? Qui décide de l’intégration ? Et surtout qu’est ce que l’intégration ? En revenant sur la notion même de l’intégration, tous trois semblent s’accorder sur l’idée que le principal obstacle reste « l’autre ». En effet, intégrés, ils le sont selon eux, mais sont-ils intégrés par la société ? Pour Lucie, « l’intégration… C’est vraiment quelque chose qui est difficile. Tu peux dire, l’intégration, dans le sens où tu connais le système, tu connais comment ça fonctionne, tu sais trouver tes repères. Ça, je dis oui, je sais comment ça fonctionne, sur le plan administratif. Il y a aussi une autre facette de l’intégration dans le sens où tu te sens chez toi. Et à ça, il y a un oui et un non. Parce qu’il a des choses qui te confronteront toujours au fait que tu ne seras jamais chez toi. […] Il y aura toujours quelque chose qui va te confronter au fait que tu n’es pas d’ici. Je pense que c’est ce qui fait que c’est impossible de vraiment t’intégrer. […] Le regard de l’autre à une influence sur ça. ». Pour sa part, Alphonse parlera de « paternalisme » et précisera, « je suis intégré, mais mon intégration n’a pas été acceptée là où je dois m’intégrer. Comment voulez-vous alors que nous parlions d’intégration. C’est des slogans politiques. » Tandis que pour Emmanuel, l’intégration est un mot creux, qui indique tout simplement le refus d’accepter l’« autre ».
Si intégrés ils se considèrent, cela signifie-t-il qu’ils ont renié le Congo ? Chacun d’entre-eux, à leur façon, ont un attachement émotionnel mais aussi politique et identitaire au Congo. Que ce soit Lucie qui envisage de retourner au Congo afin de contribuer à son développement ou encore Alphonse qui y dédie sa vie dans l’espoir de voir un jour « son pays » se reconstruire. « Malgré tout le temps que j’ai passé en Belgique, je me suis toujours battu pour mon pays, pour rentrer dans mon pays, pour y partager l’expérience, les connaissances que j’aurai acquises, pour les mettre au service du développement de ce beau grand pays. […] Toute ma vie, tout ma jeunesse, jusqu’à aujourd’hui. […] »
Laurence Grun