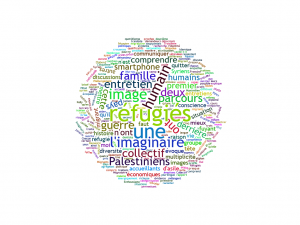« C’est son espace de vie aussi qui ne nous appartient plus pendant quelques heures, c’est bête hein mais euh, donc voilà quand on ne savait pas ce que c’était, on était des gens extrêmement généreux, et maintenant qu’on sait ce que c’est, on l’est moins donc moi c’est une petite réserve que j’ai par rapport à nous, par rapport à l’expérience euh, c’est plus facile d’être généreux quand on ne sait pas ce qu’on va faire que lorsqu’on sait ce que c’est ».
Les propos de ce père de famille bruxellois peuvent paraître forts et laisser croire que son expérience dans l’accueil de trois hommes adultes irakiens chez lui, pour l’espace d’une nuit, s’est mal passée. Or, c’est bien le contraire qui m’a été démontré et dont je ne doute aucunement. Néanmoins, il me semble tout à fait intéressant de soulever la question, à savoir quelle est cette part de « frustration » qu’a pu ressentir cet accueillant après son expérience ? Avec comme second support l’entretien d’un autre accueillant et pour qui l’expérience a été, jusqu’alors, « fructueuse », j’ai voulu dégager quelques facteurs pouvant expliquer et comprendre ce malaise qui a été éprouvé. Mais ne restant que des suppositions, au vu du caractère limité de cette part d’enquête, il ne peut être fait de généralité puisque mon explication ne reflète que mon ressenti durant cette enquête. Ainsi, en comparant les deux échantillons, j’ai relevé certaines différences notables entre elles pouvant être prises en compte :
Le degré de proximité entre accueillant et accueilli : Il est difficile de pouvoir parler de degré de proximité pour la durée d’une nuit. Néanmoins, j’ose imaginer la situation délicate du côté de l’accueilli comme de l’accueillant. Pour le premier, la gêne de se retrouver dans ces circonstances qui ne semble pas habituelles dans leur propre pays d’origine et que tous les accueillants ont perçue. « C’était des gens qui avaient probablement fait plus d’études que nous, euh, qui avaient même un meilleur niveau social que nous dans leur pays, mais qui cherchaient un endroit où l’avenir serait plus sûr pour leur famille » me dit ce même père de famille bruxellois. La fatigue qui se guettait du fait de leur long parcours éprouvant, ainsi que la barrière de la langue qui pèse sur les possibles échanges avec leurs hôtes, et vice-versa. De même que du coté des accueillants, certes en position de plus grande aisance mais qui justement, devant être dosée entre une mise à l’aise et une envie de découvrir ses invités sans que cela soit déplacé.
Le nombre de migrant accueilli lors de l’expérience (groupe / individuel) : L’échange entre migrant et accueillant a été compliqué pour les deux cotés du fait de la barrière de la langue. Sur les trois irakiens accueillis par le père de famille bruxellois, un seul balbutiait quelques mots en anglais et l’échange a pu se faire via celui-ci au nom des trois. Ils sont sortis après dîner tous les trois en ville et ont dormi dans la même pièce où, à l’origine ils devaient être séparés dans deux chambres. Peut être que, le fait que l’autre accueillant ait logé une personne seule, un jeune irakien de 25 ans, l’échange était incontournable et que son « intégration », si je puis dire, était peut être plus facile du fait que l’attention ne soit portée que sur lui.
Le maillon dont fait parti l’accueillant dans la chaîne de parcours du migrant : Le groupe des trois irakiens ont du repartir dans leur pays pour manque de solution trouvée à leur situation, tandis que le jeune irakien se trouve encore aujourd’hui en Belgique et sa situation semble se régulariser. Inconsciemment, le moral sur le sort du migrant que l’on a connu et aidé ne joue t-il pas un motif de frustration quant à l’aide que l’on a apportée ? Le maintien du contact après l’expérience avec le migrant est peut être là aussi un des points éminents. « Moi je suis content du système actuel où comme je te dis, on fait le suivi avec lui […] je pense que je préfère avec un, voire deux de plus, mais qu’ensuite je m’arrêterai là » me dit cet accueillant en parlant de ce jeune irakien devenu aujourd’hui son ami. Ce qui m’a mis la puce à l’oreille fut les paroles du père de famille bruxellois, me soumettant : « Et l’idée de parrainer, ou de sponsoriser un réfugié qui est en ordre de papier, mais qui va devoir trouver du boulot, s’inscrire peut être à des cours de français ou que sais-je, euh ‘fin, découvrir la réalité bruxelloise quoi, ça c’est, c’est aussi quelque chose qu’on pourrait aider éventuellement ! » Ne serait-ce pas là où était l’aide qu’il entendait vouloir donner ?
Ce que j’ai pu retenir, c’est qu’il n’y a pas eu de « mauvaise » expérience pour ces deux accueillants et qu’ils ne regrettent rien. Mais je ne peux m’empêcher de voir qu’à travers ces deux témoignages, la place de la « gratification » personnelle dans cette aide, soit sans frustration aucune, de ces accueillants, se situerait peut être au moment où les liens ont été tissés avec ces étrangers et que ce n’est qu’à partir de là qu’ils peuvent être satisfaits de leur geste ; accompagné par le savoir qu’ils ne sont plus dans l’urgence, un peu grâce à eux.
Carline Martinez